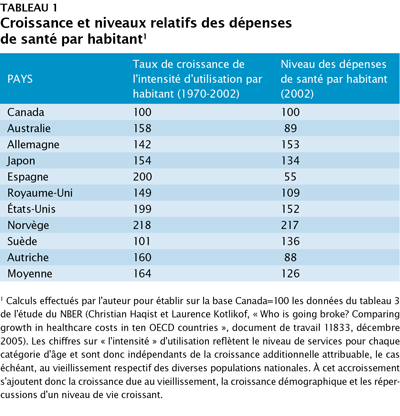Par Claude E. Forget
Claude E. Forget, pionnier de la conception, de la mise en œuvre et de l’étude des soins de santé et des services sociaux au Québec, examine l’évolution du rôle de l’État dans la santé pour en déterminer la direction future.
Je me propose ici de mettre en perspective les mesures que l’État a adoptées par le passé pour examiner ensuite la direction qu’il pourra emprunter à l’avenir. Si le processus d’établissement des politiques reflète souvent la nature imprévisible et opportuniste des luttes partisanes, il faut aussi reconnaître qu’il s’en dégage, à longue échéance, des constantes révélatrices.
Les politiques sont façonnées par des réalités inévitables et des opinions répandues. En réponse à des circonstances changeantes, l’État n’a d’autre choix que de modifier les politiques, même si les effets du changement prendront du temps à se concrétiser. Sa portée est peut-être limitée en ce qui a trait à l’innovation, mais il peut et doit exercer son leadership en façonnant la perception publique du changement.
Les principales fonctions de l’État
Bien sûr, l’État a d’autres responsabilités à part les soins de santé, et certaines ont un accès prioritaire aux deniers publics, par exemple l’infrastructure nationale, la justice, l’éducation et les programmes d’aide à la pauvreté. On distinguera un bon gouvernement d’un moins bon à sa capacité de gérer efficacement cet ensemble de responsabilités. Chaque secteur d’activité appuie les rouages de l’économie tout en contribuant à protéger les droits des individus et en favorisant la santé de la population. L’incidence de nombreuses maladies a nettement reculé grâce au développement économique et social, et ce, avant même l’arrivée de la médecine moderne.
Dans le cas de la santé, nous constatons que la demande de programmes publics augmente constamment. Le rôle fondamental de l’État dans la promotion de la santé se rapporte aux mesures relatives à la pollution, aux toxines et aux agents pathogènes transmissibles, à la santé des travailleurs et des consommateurs, et aux mesures de sécurité — du port obligatoire de la ceinture à la réglementation des médicaments d’ordonnance en passant par les politiques anti-fumée, ainsi qu’à l’application de ces mesures. Or, dans le domaine de la santé, qui a pour patient la population entière, seules des institutions étatiques peuvent agir efficacement.
L’État contribue de façon importante à la santé de la population en poursuivant des objectifs qui, de par leur nature même, constituent des mandats exclusifs. Il est tenu d’accorder la priorité aux tâches qui sont centrales à sa raison d’être, en grande partie parce qu’il est le seul agent par qui les tâches peuvent s’accomplir. La santé personnelle ne relève pas de ces tâches fondamentales, quoique l’État soit libre d’y participer, comme cela a été le cas au Canada et dans la plupart des pays européens. Cependant, quand cette participation se heurte aux fonctions principales de l’État, du moins sur le plan financier, il y aura un désengagement partiel. Celui-ci pourra s’opérer graduellement et indirectement, mais il est inéluctable.
Un aperçu historique
Au Canada, la participation du gouvernement provincial aux services de santé remonte aux années 1920. Quand le gouvernement fédéral a décidé d’entrer en scène, à la fin des années 1950, il ne souhaitait pas prendre en charge la prestation des soins (cette intention avait été explicitement niée à l’époque), mais protéger les familles contre les répercussions financières d’une maladie grave. Cela valait également pour l’assurance maladie, introduite une décennie plus tard. La loi visait « l’assurance pour soins hospitaliers » et « l’assurance pour services médicaux et diagnostiques », définissant ainsi le but restreint à l’origine des deux programmes, c’est-à-dire payer pour des services fournis et contrôlés par des tiers.
Les choses en sont restées là jusqu’à l’adoption par le Parlement de la Loi canadienne sur la santé, au début des années 1980. Dans les 25 années qui ont suivi, le sens donné aux concepts d’universalité, d’intégralité, de gestion publique et de transférabilité établis par la Loi a nettement changé. Conçus comme des protocoles administratifs, uniquement pertinents dans le cadre d’ententes fédérales-provinciales, ces concepts sont désormais les « principes » qui encadrent le système de santé canadien — le terme « assurance » ayant disparu du vocabulaire officiel en cours de route. Cela a eu pour effet de créer, au sein de la bureaucratie et du public, de nouvelles attentes centrées sur la notion de garantie gouvernementale des droits individuels aux soins de santé. Ce n’est pas par hasard que la Loi a été adoptée seulement quelques années après que le gouvernement fédéral eut modifié les règles de sa responsabilité financière, remplaçant le modèle du partage des coûts par des subventions fixes établies en fonction du nombre d’habitants et déterminées arbitrairement lors de « négociations ». Essentiellement, la Loi autorisait le gouvernement fédéral à s’engager au nom des provinces, sans toutefois les consulter. Sur le plan politique, il s’agissait d’un compromis très attrayant pour le fédéral.
Les provinces, réduites au rôle de « propriétaires d’actif », se sont engagées plus avant dans la gestion des soins. Ont suivi des réorganisations de toutes sortes, dont la régionalisation et les cliniques communautaires ; cependant, l’efficacité des nombreux changements apportés ne peut être évaluée, faute de données empiriques. Mais surtout, après 30 années d’efforts visant à gérer directement les systèmes provinciaux, force est de constater que ceux-ci ne sont pas encore stables ni même viables. Ce constat inquiétant découle de la convergence de trois facteurs, probablement incontrôlables et partiellement auto-imposés qui, selon moi, ont créé le « triangle des Bermudes » de la santé.
Les soins de santé dans le triangle des Bermudes
Les progrès scientifiques
Sur le premier côté du triangle, on trouve les progrès scientifiques et technologiques. Par exemple, depuis 2005, les États-Unis ont consacré annuellement 100 milliards de dollars à la recherche-développement (R.D.) et le reste du monde, environ le double de cette somme. Cet effort gigantesque a produit des médicaments, des instruments médicaux et un savoir qui sont à l’origine de la révolution des soins. Les innovations et les découvertes se diffusent rapidement dans le monde hyperconnecté qui est maintenant le nôtre, relevant sans cesse les normes de soins.
Les études se contredisent quant aux conséquences de cet apport régulier d’innovations sur les coûts de la santé. Certains croient que les innovations expliquent 70 % de la hausse des coûts, en sus de l’inflation, et d’autres pensent que c’est encore plus. Cependant, une chose est sûre : le progrès scientifique n’est pas gratuit, car les innovations visent toujours à faire « plus » et « mieux ». Même des innovations comme les chirurgies non effractives ou les meilleures anesthésies qui devaient réduire les coûts en écourtant le séjour à l’hôpital ont fini par les augmenter, car les patients jusque-là trop frêles pour subir une intervention invasive pouvaient maintenant se faire soigner.
Aujourd’hui, la médecine est sur le point de connaître un changement radical. La recherche génomique nous offre un avenir rempli de remèdes qui paraissent aujourd’hui miraculeux : des médicaments « griffés », la régénération de membres coupés et la réparation de cellules du système nerveux central. Qui sait si la médecine personnalisée, comme on la nomme parfois, sera à la hauteur de ses promesses, mais certains miracles annoncés pourront être à notre portée dans la prochaine décennie. Et ça ne sera pas bon marché.
La culture de consommation
Sur le deuxième côté du triangle, on trouve l’amélioration progressive des normes de soins, un phénomène qui a peu à voir avec la R.D. Le principe « ne pas nuire » a toujours été une pierre angulaire de la médecine, mais depuis quelques décennies, la communauté de la santé a pris des mesures concertées contre les erreurs médicales. Les soins sont rationalisés selon une analyse fondée sur les résultats, une collaboration multidisciplinaire et la consultation du patient, et l’accent est mis sur la qualité. L’amélioration des normes de soins est une conséquence de notre orientation consommateur. Nous vivons à l’ère des organismes de protection du consommateur et des recours collectifs. Et mondialisation oblige, ce qui est disponible ailleurs doit l’être ici aussi.
Cette tendance de plus en plus marquée dans les soins de santé se manifeste dans notre rapport à la Loi canadienne sur la santé. Au début des années 1980, on considérait que la Loi établissait un certain nombre de « principes ». Depuis, les politiciens de toutes les allégeances ont traité ces principes comme le Saint-Graal, et plus récemment, ils ont découvert qu’ils étaient exécutoires. En 2005, l’arrêt Chaoulli c. Québec a établi qu’un patient ne doit pas être soumis à des délais d’attente excessifs pour l’obtention de soins. Désormais, les gouvernements sont obligés de prendre des mesures en vue de réduire les temps d’attente et de fournir des procédures diagnostiques et thérapeutiques qui sont couramment utilisées dans d’autres pays riches.
L’amélioration des normes de soins en termes de sécurité, de diligence et de prise en charge agit en synergie avec les nouvelles technologies pour augmenter les coûts.
Une productivité stagnante par nature
Sur le troisième et dernier côté du triangle se trouve une tendance inhérente au secteur de la santé (même si les technologies et les normes demeurent inchangées), à savoir l’augmentation des coûts par rapport à ceux d’autres secteurs de l’économie. Et pour une raison simple : la santé est strictement un secteur de service. Dans des domaines comme l’exploitation minière, l’agriculture et la fabrication, les volumes de production ont progressé malgré la rationalisation de la main-d’œuvre. En d’autres mots, la productivité a augmenté. Bien que les ressources humaines du réseau de la santé n’aient pas diminué par rapport à ce qu’elles « produisent », les salaires du personnel ont néanmoins suivi ceux d’autres secteurs ayant dégagé des gains de productivité. En bout de ligne, le système de santé coûte plus cher en soi et plus cher par rapport au reste de l’économie. Pourtant, nous ne tenons pas vraiment à ce que la productivité des ressources humaines engagées directement dans les soins augmente, car cela réduirait les contacts humains entre le fournisseur de soins et le patient.
Un ouragan qui se prépare
En eux-mêmes, les facteurs à l’origine du triangle des Bermudes de la santé sont de bonnes choses. Nous accueillons favorablement les innovations qui donnent lieu à des traitements efficaces. Nous participons à l’effort mondial de recherche, applaudissons les soins centrés sur le patient et permettons à nos tribunaux de veiller à ce que les vastes programmes gouvernementaux respectent les lignes directrices et les principes. De même, il est essentiel que la rémunération et les conditions de travail dans un secteur aussi important que la santé soient proportionnels à ceux d’autres secteurs, en dépit de l’absence de gains de productivité. Cependant, avec l’importance grandissante de toutes ces bonnes choses, le lent tourbillon au centre du triangle risque de se transformer en ouragan. Avec toutes ces bonnes choses, pourrons-nous soutenir le système actuel ?
La contrainte du payeur unique
On a souvent vanté la supériorité du système canadien « à payeur unique » pour le financement des services de santé, surtout en comparaison avec la situation américaine.
Il y a une génération, alors que j’étais ministre de la Santé du Québec, j’ai utilisé le terme « rationnement » lors d’une conférence de presse. J’avais dit qu’avec l’arrivée de l’assurance maladie et le retrait des mécanismes de prix contrôlant l’accès aux services (même après l’adoption de l’assurance hospitalisation, on exigeait des frais pour les visites ambulatoires), il fallait instaurer un autre instrument de rationnement. Pour le naïf ex-professeur d’économie que j’étais, le rationnement était littéralement un mécanisme capable d’assurer un accès universel équitable aux ressources limitées. Les éditoriaux du lendemain étaient cinglants !
Malgré le déplaisir que cette notion suscite dans ce pays, le rationnement est une pratique courante. Certaines méthodes sont assez évidentes : fermeture d’hôpitaux, compressions budgétaires, retards dans le financement, restrictions dans l’assurance médicaments et contingentement des admissions dans les facultés de médecine et des postes de résidence sont des formes de rationnement qui contrôlent les coûts dans une certaine mesure, bien qu’elles ne soient jamais ouvertement reconnues comme telles. Les méthodes de contrôle des coûts adoptées ici contrastent nettement avec les techniques brutales utilisées par les assureurs privés aux États-Unis.
Pourtant, ces mesures n’ont pas suffi à contenir la participation financière toujours plus grande de l’État. Des signes indiquent que d’autres mécanismes sont à l’œuvre.
Une utilisation modeste des ressources
Selon les données de l’OCDE, des interventions comme les pontages et la dialyse sont pratiquées deux ou trois fois plus souvent aux États-Unis qu’au Canada (taux par 100 000 habitants). Se pourrait-il que les professionnels de la santé canadiens utilisent plus modestement les méthodes diagnostiques et thérapeutiques ?
Des services privés facultatifs
Aussi désavouée soit-elle, la médecine à deux vitesses est de plus en plus présente, à tel point qu’elle est aujourd’hui une réalité discrètement et relativement bien acceptée. Elle se pratique surtout en dehors du milieu hospitalier, où l’on peut réduire de façon radicale et en toute légalité le temps d’attente pour certaines interventions en payant de sa poche. De même, les hôpitaux offrent une multitude d’avantages « optionnels » en plus des services payés par l’État, dont certaines prothèses ophtalmologiques et orthopédiques, des produits de contraste dans les radiographies et divers médicaments. La légitimité des services facultatifs fait l’objet d’une continuelle interprétation.
Les dons privés
Les dons privés jouent encore un rôle vital, comme c’était le cas avant l’assurance maladie publique, surtout dans les secteurs clairement sous-financés par les gouvernements, notamment l’infrastructure de nos institutions et leur besoin de capital toujours plus grand pour se procurer de l’équipement toujours plus sophistiqué.
La prestation privée des soins
En réponse à l’arrêt Chaoulli, l’État a affecté plus de fonds à la réduction des temps d’attente pour des chirurgies précises, notamment en utilisant et en payant des cliniques privées. Cette mesure, qui visait à préserver l’intégrité du système public, démontre à quel point il est difficile pour ce système de s’adapter même lorsqu’on lui en donne expressément le mandat.
Le tourisme médical
Il se peut que le tourisme médical vienne jouer un rôle central dans la réduction des coûts du secteur public. Aux États-Unis, environ un million d’Américains iront à l’étranger cette année pour recevoir un traitement à une fraction du coût exigé chez eux. Les assureurs privés appuient cette pratique. Les gouvernements canadiens, en difficulté financière, pourraient-ils en faire autant ?
Intensité d’utilisation des services
Il semble que le gouvernement canadien ait mieux réussi que la plupart des pays à contrôler ses coûts de santé. Une étude du National Bureau for Economic Research, publiée en 2005 et réalisée à partir des données de l’OCDE, a analysé les coûts liés a la de santé de 10 pays entre 1970 et 2002 (Tableau 1). Au Canada, le taux de croissance de l’intensité d’utilisation des services de santé est demeuré inférieur à la moyenne. Cela étant, en 2002, notre niveau de dépenses en matière de santé par habitant était 25 % moins élevé que le niveau moyen des 10 pays étudiés et bien en deçà de celui de quelques pays, dont la Suède, la Norvège, l’Allemagne, les États-Unis et le Japon. Le taux de croissance de l’intensité d’utilisation correspond à l’augmentation des dépenses après prise en compte du vieillissement et de la croissance démographique et économique. C’est une croissance d’utilisation « pure » dans un monde hypothétique où rien d’autre ne change.
Ces données comprennent toutes les dépenses, que le financement soit d’origine publique ou privée, et démontrent que les dépenses privées jouent un rôle dans la hausse des dépenses totales sans toutefois modérer la hausse des dépenses publiques. Dans la plupart des pays, ces dernières ont augmenté plus rapidement qu’au Canada.
Les chiffres montrent ce qui s’est produit et non ce qui aurait dû se produire. Le niveau inférieur des dépenses canadiennes est-il optimal ou indique-t-il plutôt qu’un rattrapage s’impose ?
La pression monte
En ce qui concerne le Canada, le taux de croissance des dépenses totales et des dépenses publiques, bien qu’il soit relativement faible, dépasse tout de même de deux ou trois points de pourcentage le taux de croissance de l’économie. Donc, les dépenses publiques pour la santé grignotent les fonds destinés à d’autres portefeuilles publics, dont certains relèvent plus étroitement du rôle essentiel de l’État.
Pour le gouvernement, la réponse évidente serait d’augmenter les impôts et de rendre le système public plus efficace. Après tout, le public canadien a dit et redit que la santé était l’une des priorités les plus importantes.
Pourtant, le gouvernement n’a pas haussé les impôts et il semble peu probable qu’il le fasse dans un proche avenir. Dans les années 1980, alors que les coûts de la santé grimpaient particulièrement vite, les gouvernements ont préféré les déficits à la hausse d’impôt, et quand le déficit est devenu intenable, ils ont réduit le budget de la santé et non augmenté la ponction fiscale. Aujourd’hui, pour de nouvelles raisons fort convaincantes, des hausses d’impôt en vue de financer le système public de santé sont encore moins probables. Avec le niveau de vie de la Chine et de l’Inde qui se rapprochent du nôtre, l’ère des denrées alimentaires et de l’énergie bon marché est terminée, peut-être à tout jamais. De même, avec l’augmentation rapide des salaires et du taux de change de ces deux pays, les produits manufacturés commenceront à coûter plus cher. Des pressions diverses s’exerceront à long terme sur notre mode de vie. Il s’agit d’un contexte politique peu favorables aux hausses d’impôt, et il faut donc trouver d’autres moyens de relâcher la pression.
Quelle direction emprunter ?
Compte tenu de ces facteurs, en quoi la participation de l’État à la santé va-t-elle changer ? Avant toute chose, nous devons cesser de nous mentir. Nous avons un grave problème : comment maintenir sans aucun changement la totalité d’un système qui, pris au pied de la lettre, promet virtuellement tout à tout le monde ?
À moins que ne survienne un miracle dans le développement de la connaissance, il faudra inévitablement réduire de façon importante les services de santé personnels assurés par le régime public, et ce non pas de 10 % ou de 15 %, mais plutôt de 40 %.
Pour accomplir cette amputation d’un régime qui promet tous les services (le principe d’intégralité) à tout le monde (le principe d’universalité), il faudra faire un choix. Je crois et j’espère qu’on maintiendra l’universalité et qu’on sacrifiera l’intégralité. Toutefois, il peut s’agir là de mes préférences, et non des probabilités.
Quoiqu’il advienne, le résultat sera façonné par la structure de gouvernance de notre système de santé. Dire qu’il s’agit d’un système à payeur unique n’est pas tout à fait juste, car dans les faits, c’est un régime à deux payeurs. Dans ce dossier complexe et politiquement explosif, aucune modification importante ne pourra être apportée sans que les gouvernements provinciaux et fédéral ne parviennent à une entente. Tout scénario concevable se compliquera des motivations diverses qui animent les politiciens fédéraux et provinciaux. Au provincial, ils sont motivés par un unique impératif, à savoir éviter le démantèlement du régime « patrimonial » qu’ils gèrent, ce qui serait une catastrophe pour les citoyens, mais une source de pro?fond embarras et une défaite pour eux. Au fédéral, les politiciens sont motivés par le désir de paraître utiles tout en évitant soigneusement de participer pleinement aux risques et aux coûts du régime patrimonial : cela les amène à favoriser des engagements financiers marginaux et limités dans le temps, destinés à des fins étroitement définies et « innovatrices ».
En période de changement, la rigidité dans l’élaboration des politiques est la pire des malédictions. La vie poursuit son cours et ceux qui sont incapables de voir venir les changements et de prendre l’initiative de s’adapter seront nécessairement déçus. Le premier patient à examiner devrait être la structure de gouvernance du régime public. Pourtant, il ne se passe rien.
Les prévisionnistes privilégient toujours le long terme. Ils prévoient la température et annoncent du temps pluvieux ou ensoleillé, et auront toujours raison s’ils ne précisent pas quand arrivera la pluie ou le beau temps. Je ne ferai donc pas de prévision concernant l’évolution du rôle de l’État dans le financement des services de santé personnels, mais je m’aventurerai à dire que d’importants changements surviendront dans les cinq à sept prochaines années. C’est un dossier à suivre.